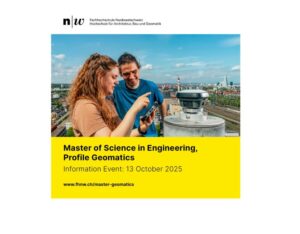L'utilisation de l'énergie hydraulique dans les Alpes est une histoire à succès de l'ingénierie suisse et de l'énergie renouvelable. Mais la construction de barrages et de centrales hydroélectriques est aussi une histoire d'expulsion, d'expropriation et de résistance. Dans une nouvelle installation vidéo, dix témoins de l'époque racontent leurs expériences personnelles. La résistance aux projets hydroélectriques existe depuis le début. Dans un premier temps, elle est surtout dirigée contre la perte de la patrie, puis, à partir des années 1940, de plus en plus contre les répercussions sur l'environnement. Des initiatives politiques ont été prises contre la construction de nouvelles installations, mais elles n'ont généralement pas obtenu la majorité. Le mouvement environnemental né dans les années 1970 à l'échelle de la Suisse s'est également engagé pour la protection des Alpes. Il a remporté un succès important dans les années 1980, lorsqu'un projet de lac de retenue menaçait la plaine de la Greina. Le directeur de la "Fondation Greina", Gallus Cadonau, faisait partie des organisateurs de la résistance. Il s'est engagé pour la préservation du paysage en proposant de nouvelles solutions, comme par exemple le "centime paysager" - une indemnité versée aux communes de montagne pour qu'elles renoncent aux projets hydroélectriques. Celle-ci leur permettait de renoncer à la vente d'une concession, seul moyen de sortir de l'appauvrissement.
Près de 60 pour cent de l'électricité suisse provient de l'énergie hydraulique. Les barrages et leurs centrales, dont la plupart ont été construits après la Seconde Guerre mondiale, ne sont pas seulement les projets du siècle, mais aussi le moteur du miracle économique. Dans l'installation vidéo, les perspectives d'Amédée Kronig et d'Eric Wuilloud montrent le potentiel de l'énergie hydraulique. Amédée Kronig a été directeur de Grande Dixence SA de 2011 à 2023. Construit de 1951 à 1961, ce barrage est encore aujourd'hui le plus haut barrage-poids du monde avec ses 285 mètres de hauteur. Eric Wuilloud a dirigé le projet de la centrale de pompage-turbinage "Nant de Drance", considérée comme l'une des plus puissantes d'Europe. Wuilloud plaide pour une utilisation responsable des ressources : grâce aux centrales de pompage-turbinage, l'électricité excédentaire peut être investie dans un approvisionnement fiable par des énergies renouvelables en hiver. Expériences suisses - Énergie hydraulique et résistance - Landesmuseum Zürich
De 1932 à 1937, le plus grand lac de retenue de Suisse en termes de superficie est construit dans les Préalpes : le Sihlsee. 1762 personnes sont contraintes de se déplacer et 55 exploitations agricoles sont inondées. Plusieurs familles privées de leurs moyens de subsistance émigrent aux États-Unis. Liaison routière au-dessus du niveau du futur plan d'eau et exploitations agricoles devant céder la place au projet de barrage, avant 1935. Copyright : © Archives sociales suisses, photo : Karl Saurer, Einsiedeln/F 5067-Fb-222